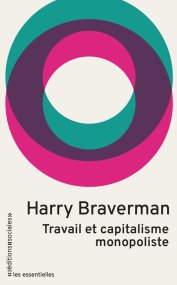À l’occasion de la réédition anniversaire de Travail et capitalisme monopoliste de Harry Braverman aux Éditions sociales nous nous entretenons avec Juan Sebastian Carbonell, sociologue du travail et préfacier du livre, sur l’actualité de la pensée de Braverman.
Soutenez l’édition indépendante, achetez en librairie.
Détails sur le site de l’éditeur
RP Dimanche : Qui était Harry Braverman et pourquoi il est important de le relire aujourd’hui ?
Juan Sebastian Carbonell : La trajectoire intellectuelle et politique de Harry Braverman est passionnante parce qu’elle croise celle de la gauche socialiste américaine et celle du milieu intellectuel des années 1940-1960. C’est pour cela qu’il n’est pas si simple de dire qui était Braverman. On le connaît comme l’auteur de Travail et capitalisme monopoliste, mais il a longtemps été ouvrier dans l’industrie, et un des dirigeants du trotskisme américain, avant de devenir éditeur, puis auteur d’un des livres les plus lus et commentés au monde sur le travail.
On a malheureusement peu de sources sur la vie de Braverman. Il manque un vrai travail d’historien.ne qui se penche sur cette trajectoire qui est à l’intersection de plusieurs milieux. Les données qu’on a sur sa vie proviennent pour la plupart de témoignages de ses anciens camarades, ce qui permet reconstituer partiellement sa trajectoire. On sait qu’il se rapproche de la gauche socialiste alors qu’il est un adolescent, fils d’immigrés juifs polonais, dans les années 1920 à Brooklyn, et notamment de la Young People’s Socialist League (YPSL). Il s’agit de l’organisation de jeunesse du Parti socialiste, mais elle est de fait indépendante, et bien plus à gauche que celui-ci, parce qu’influencée par d’autres courants de la gauche. C’est là où Braverman commence à côtoyer des trotskistes, avec qui il sera exclu du YPSL, et avec qui il fonde le Socialist Workers Party en 1938, où il va militer une quinzaine d’années.
Parallèlement à cette carrière militante il travaille comme ouvrier dans divers métiers industriels. Dès ses 16 ans, il commence à travailler en tant qu’apprenti chaudronnier dans les chantiers navals Brooklyn Naval Yards. Il exerce une activité qualifiée, et vient à diriger une équipe d’une vingtaine d’ouvriers, tout en militant dans des organisations trotskistes. Cela ne va pas sans risques parce qu’il est licencié à une occasion en raison de ses activités militantes. Pendant la guerre il est envoyé dans le Wyoming pour travailler sur des locomotives. Dans l’après-guerre il continue de travailler dans l’industrie, cette fois-ci dans une aciérie.
Après son exclusion du SWP en 1953, Braverman quitte le monde industriel pour diriger la revue mensuelle de sa nouvelle organisation, la Socialist Union of America. Il exerce le métier de correcteur et de typographe dans l’American Socialist, tout en rédigeant divers articles d’histoire, de politique ou de sociologie, dont certains préfigurent Travail et capitalisme monopoliste. Après la disparition de son organisation et de sa revue, Braverman travaille comme éditeur chez Grove Press, puis chez Monthly Review Press, maison d’édition de la revue éponyme. La Monthly Review est une revue sans équivalent dans le monde francophone. C’est une revue « socialiste », d’extrême gauche et marxiste hétérodoxe, et qui se veut indépendante de tous les partis politiques de la gauche américaine. Braverman va diriger la maison d’édition jusqu’à sa mort prématurée en 1976, deux ans après avoir publié Travail et capitalisme monopoliste, son seul ouvrage.
La conjonction de cette triple expérience (en tant qu’ouvrier, militant et éditeur), a permis à Braverman d’avoir une vision d’ensemble des transformations du monde du travail et de forger sa propre critique de l’organisation du travail. Lorsque Travail et capitalisme monopoliste paraît, le livre est un succès immédiat. On parle même à cette époque de « bravermania », en raison de l’engouement qu’il suscite alors. L’édition anglaise se vend à plus de 150 000 exemplaires et ses thèses sont discutées dans toute la gauche parce qu’il touche à quelque chose de profond dans le mal-être au travail à l’époque, et qui a beaucoup d’échos aujourd’hui : démotivation, insatisfaction, perte de sens, etc.
RP D : Justement, quel est le projet théorique et politique de son livre et ses principales thèses ?
JSC : Braverman s’attelle à faire une critique de l’organisation scientifique du travail. Il part de la contradiction entre les discours ambiants sur le travail et comment l’incorporation de connaissances scientifiques dans le processus de travail rendrait celui-ci plus intéressant, et la réalité du monde du travail, l’insatisfaction au travail, qui évoquent par bien des aspects la « crise du travail » dont on parle aujourd’hui. Il faut se rappeler que Braverman écrit au début des années 1970, on est en plein dans les « années 68 » et dans la « crise de l’usine » dont parle Xavier Vigna, c’est-à-dire de l’insubordination au travail, notamment dans les métiers manuels, c’est-à-dire le rejet d’un travail vu comme pénible et abrutissant, et d’une discipline au travail autoritaire.
Ce qui intéresse Braverman c’est donc le processus de travail sous la domination du capital et comment celui-ci est sans cesse transformé sous la pression de l’accumulation du capital. Il ne s’intéresse pas qu’au travail dans sa dimension technique, mais également dans sa dimension politique. Autrement dit, le processus de travail n’a pas qu’une dimension technique, il ne fait pas que produire des valeurs d’usage, il est aussi un processus d’expansion du capital. D’où l’enjeu pour les capitalistes de réaliser la « pleine utilisation » de la force de travail qui a été achetée. Pour les travailleuses et travailleurs, ceci se traduit par un changement continuel des conditions de travail et par une redistribution de la main-d’œuvre entre catégories et secteurs d’emploi. Il montre que derrière ce que l’on appelle le « taylorisme », cette recherche du « one best way », se cache la dissociation entre conception et exécution, entre ceux qui organisent le travail et ceux qui l’exécutent. Il parle dans ce sens du « démembrement du travailleur » et d’un « rabaissement de la classe ouvrière » sous l’effet de l’organisation du travail, d’où le sous-titre de son livre : la dégradation du travail au XXe siècle.
Braverman ne se limite pas à étudier le monde industriel, il applique ses analyses au monde des employé.e.s, qui est une couche sociale qui se développe dans l’après-guerre, et qui fait dire à de nombreux sociologues qu’il s’agirait d’une nouvelle classe ouvrière, ou que les analyses de Marx seraient périmées. Pourtant, les employé.e.s n’échappent pas à la dynamique de dissociation entre conception et exécution. Une quantité de travail toujours plus grande est nécessaire non plus pour produire, mais pour assurer les conditions nécessaires à la production et à la circulation des marchandises, à la certification, à la vérification et aux contrôles.
Ce qui fait dire à Braverman que le monde des employés devient alors un « vaste empire de papier ». Le travail des employé.e.s fait donc aussi l’objet de l’application méthodique de l’« organisation scientifique du travail », avec le chronométrage, la rationalisation des gestes et des déplacements, la mécanisation (ou digitalisation comme on dirait aujourd’hui), etc. Il a ici une intuition qui est par la suite devenue de l’ordre du sens commun dans les sciences sociales : les conditions de travail des employé.e.s et des ouvriers ont tendance à converger.
RP D : Dans ta préface à la nouvelle édition du livre, tu reviens non seulement sur la trajectoire atypique de Braverman, mais aussi sur ses apports à la théorie marxiste. Peux-tu nous en dire plus ?
JSC : Braverman s’est beaucoup nourri du marxisme et des théories sociologiques de son temps, ce qui en fait un marxiste ouvert à des idées nouvelles, qu’il critiquait, mais qu’il intégrait aussi dans son travail. C’est ce qui lui permet de faire un double décalage dans Travail et capitalisme monopoliste par rapport au marxisme de son époque.
Premièrement, il essaie de combler le vide dans la théorie marxiste dans l’analyse du processus du travail depuis Marx et le livre 1 du Capital. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, le marxisme s’est consacré à l’étude d’autres sujets, tels que l’État et le pouvoir, des questions plus « urgentes », en quelque sorte pendant toute la première partie du XXe siècle. De la même façon, dans une grande partie du marxisme classique, la question des rapports de production était perçue comme secondaire : la prise du pouvoir par les travailleur.euses allait la résoudre. Il suffirait de remplacer la propriété des moyens de production par une production socialisée, sans forcément changer l’organisation du travail ou les rapports de travail. L’ouvrage de Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor, fait le bilan de cet impensé dans une partie du marxisme, et rappelle que par exemple Lénine voyait dans le taylorisme une « distribution rationnelle et raisonnée du travail à l’intérieur de la fabrique ».
Deuxièmement, Braverman adopte une définition dynamique des classes sociales. On voit dans les références citées dans son livre qu’il était un lecteur de Edward P. Thompson, historien marxiste britannique, et donc que sa conception à lui des classes sociales l’a influencée. Braverman reprend de Thompson l’idée qu’il faut refuser toute définition a priori des classes sociales, ou toute définition de la classe ouvrière « en soi ». Pour lui, toute définition « mathématique » de ce type, et que l’on trouve dans toute une partie du marxisme (on n’a qu’à penser à la définition « distinctive » selon Michel Verret dans la sociologie française) apporterait plus de confusion qu’autre chose. Plutôt, la classe est un processus historique. Ce qui compte c’est la façon dont l’accumulation du capital modifie la composition de la classe ouvrière et la déplace d’un secteur de l’économie à un autre.
RP D : Braverman affirme que le marxisme n’a d’intérêt que comme « outil pour la lutte » : selon toi, à l’heure du bilan de la bataille des retraites, qu’apporte Braverman sur le terrain de l’analyse ? Et sur celui de la stratégie ?
JSC : Une des principales critiques adressées à Travail et capitalisme monopoliste est que le livre ne traite pas de la question du syndicalisme ou des grèves, et de ce que le marxisme appelle la « conscience de classe » ou la « subjectivité ». Toutefois, Braverman rappelle dans le texte « Deux remarques », qu’on a inclut en annexe à cette réédition de 2023, le rôle qu’il donnait à son livre. À travers celui-ci, il cherche à fournir une « image concrète » de la classe ouvrière de son époque, de l’évolution de sa composition, de ses qualifications, etc. Étape nécessaire selon lui afin de s’atteler à la deuxième tâche, qui consistait selon lui à étudier les expériences récentes de luttes de travailleur.euses.
J’ajouterais que toute la trajectoire de Braverman est là pour rappeler que son ouvrage n’est pas un exercice universitaire, qu’il cherche à donner un « outil pour la lutte ». Braverman était un militant avant d’être un intellectuel, un sociologue, ou un économiste. En passant en revue les théories et les études de son époque sur l’évolution du travail, il essaie de déceler entre le vrai et le faux dans celles-ci. Il arrive à la conclusion qu’il y a une tendance à la « dégradation du travail » sous le capitalisme (dont la nature, la portée et les origines ont été très débattues par la suite), et que l’insatisfaction au travail a pour origine l’organisation du travail elle-même. Cela a évidemment des résonances avec ce que l’on a vécu ces derniers mois en France, avec la mobilisation contre la réforme des retraites. En quelque sorte, on peut lire Braverman à la lumière de la mobilisation contre la réforme des retraites, parce que la question des conditions de travail, voire celle du sens du travail a été au cœur du mouvement. Si celui-ci a été si populaire, c’est parce que pour de nombreux.euses manifestant.e.s, il est hors de question de travailler deux ans de plus dans les mêmes conditions.
On peut dire que jusqu’au Covid-19, en France, les débats sur le travail se sont beaucoup focalisés sur l’emploi, notamment sur le nombre d’emplois disponibles, suite à la crise économique de 2008, et en raison d’un taux de chômage relativement élevé. Les choses ont changé, surtout après les confinements, lorsqu’on a commencé à s’intéresser à la dimension qualitative du travail, aux conditions de travail et au sens du travail. Surtout, avec la mobilisation contre la réforme des retraites on a enfin pu débattre du travail et de son contenu. Elle a été l’occasion de rappeler à quel point le travail est devenu pénible. Par exemple, selon la Dares, un tiers des actifs déclare que leur travail est « insoutenable ». Plus précisément, 37 % des actifs disent ne pas se sentir capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite. Ça ne concerne pas que les métiers d’exécution : 39 % des ouvriers et des employés déclarent leur travail insoutenable, mais aussi 32 % des cadres. C’est-à-dire que le mal-être au travail s’est généralisé, par delà les catégories professionnelles. Travail et capitalisme monopoliste a adressé ces questions dans les années 1970, en offrant des éléments d’explication et de compréhension de ces phénomènes. 50 ans plus tard, ses analyses restent d’une très grande actualité.