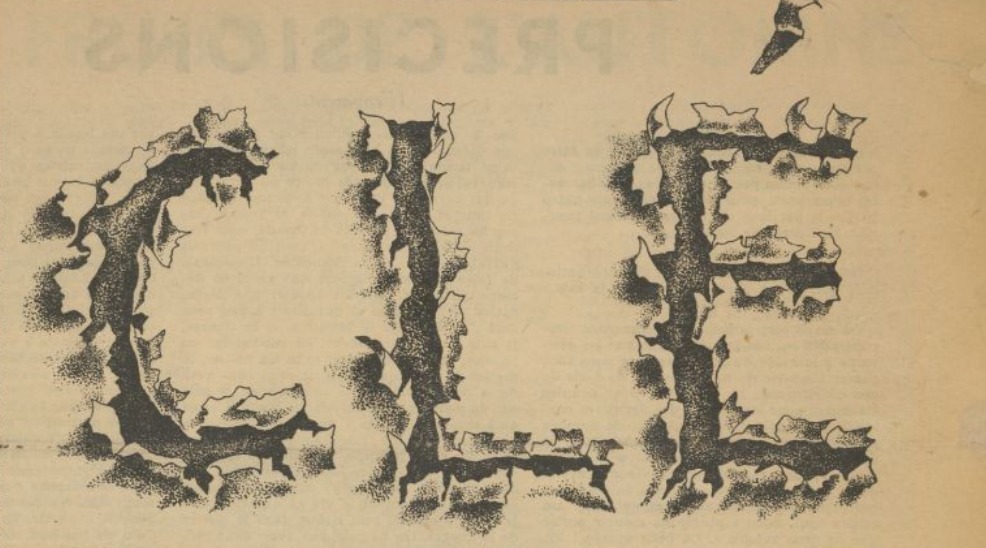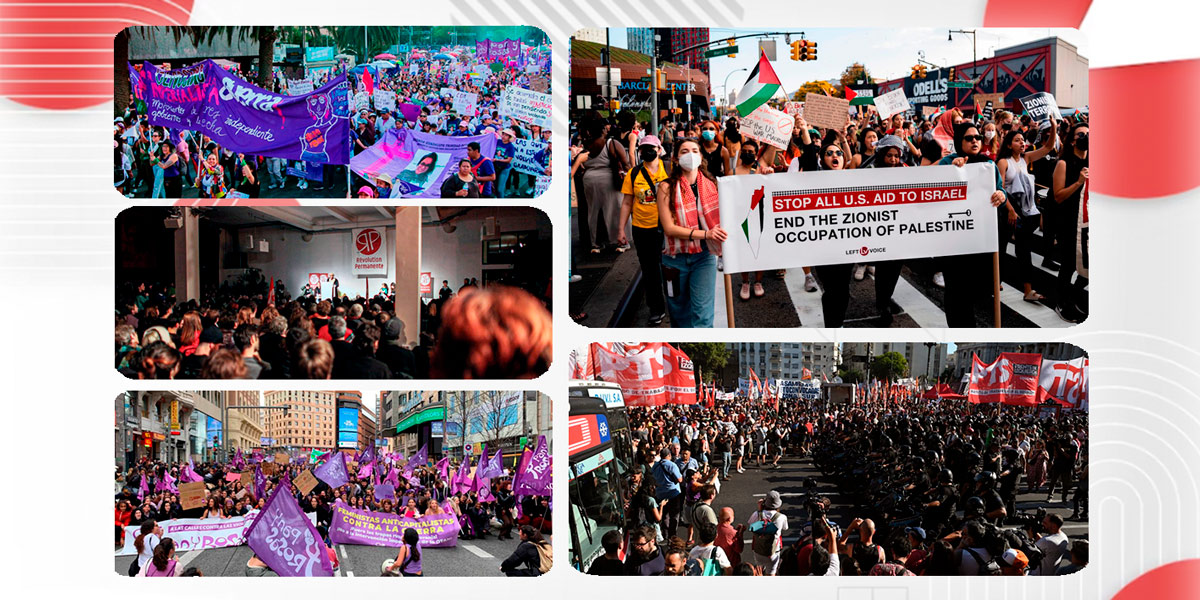« Je voudrais que ce livre soit répandu à des millions d’exemplaires et traduit dans toutes les langues, car il donne un tableau exact et extraordinairement vivant d’évènements qui ont une si grande importance pour comprendre ce qu’est la révolution prolétarienne, ce qu’est la dictature du prolétariat ». Ces mots ont été écrits en 1919 par Lénine dans l’une des préfaces du livre de John Reed.
Et ces mots décrivent effectivement la profondeur de cet ouvrage. Nous reproduisons ci-dessous un passage qui exprime comment la classe ouvrière avançait vers la victoire ; le lecteur est amené peu à peu à découvrir comment s’exprimait la dictature du prolétariat au front, malgré le fait que dans la forme certains éléments pouvaient sembler paradoxaux pour un observateur peu attentif.
John Reed avait été envoyé en Russie par le journal socialiste The Masses en 1917 pour couvrir la révolution. Cependant, ce journal refusera de publier ses articles. C’est Max Eastman qui acceptera de publier les articles de Reed dans son journal, The Liberator. Reed avait également couvert la révolution mexicaine de 1917. En 1916, il avait publié un livre en Angleterre et aux Etats Unis sur la guerre dans les Balkans, à la veille de la révolution russe.
John Reed est mort en 1920 de typhus à Moscou, après s’être rendu au congrès des peuples d’Orient à Bakou (Azerbaïdjan). Des funérailles officielles ont été organisées sur la Place Rouge pour rendre hommage à ce grand journaliste révolutionnaire et internationaliste.
Extrait du chapitre « La victoire » :
Le camion repartit dans la direction de Romanovo. Au premier croissement, deux soldats s’élancèrent au-devant de nous, brandissant leurs fusils. Nous ralentîmes, puis stoppâmes.
– Vos laissez-passer, camarades ?
Les gardes rouges poussèrent une grande clameur.
– Nous sommes des gardes rouges. Nous n’avons pas besoin de laissez-passer… En avant ! Ils nous embêtent !…
Mais un matelot observa :
– Nous faisons mal, camarades ! Il faut respecter la discipline révolutionnaire. Supposez que des contre-révolutionnaires arrivent en camion et disent : « nous n’avons pas besoin de laissez-passer ». Les camarades ne nous connaissent pas.
Une discussion s’engagea. Un par un, cependant, les matelots et soldats se rallièrent à l’avis du premier. En murmurant, ils sortirent leurs papiers crasseux. Tous étaient semblables, sauf le mien, établi par l’état-major révolutionnaire de Smolny. Les sentinelles m’enjoignirent de les suivre. Les gardes rouges protestèrent avec énergie, mais le matelot qui avait pris précédemment la parole déclara :
– Nous avons parfaitement que ce camarade est un vrai camarade. Mais il y a des ordres du Comité, auxquels il faut obéir. C’est la discipline révolutionnaire…
Afin de ne pas créer des difficultés, je descendis. Je regardai le camion s’éloigner sur la route ; toute la compagnie me faisait des signes d’adieu. Les soldats délibérèrent un instant à voix basse, puis me conduisirent vers un mur contre lequel ils me placèrent. Je compris soudain : ils allaient me fusiller.
Pas un être humain en vue. Le seul signe de vie était une fumée qui s’élevait d’une petite maisonnette en bois, à un quart de mille de route. Les deux soldats se dirigèrent vers la route. Désespérément, je me lançai à leur poursuite.
– Mais, camarades, regardez donc ! Voilà le cachet du Comité militaire révolutionnaire.
Ils fixèrent d’un œil hébété mon laissez-passer, puis échangèrent un regard.
– Il n’est pas comme les autres, prononça l’un d’eux avec entêtement. Nous ne savons pas lire, frère.
Je le pris par le bras.
– Allons, lui dis-je, jusqu’à cette maison ; il y aura surement quelqu’un qui sache lire.
Ils hésitèrent.
– Non, fit l’un.
L’autre me dévisagea.
– Pourquoi pas ? marmonna-t-il. Tout de même, c’est un grand crime de tuer un innocent.
Nous allâmes donc jusqu’à la porte de la maison et nous frappâmes. Une petite femme replète vint ouvrir et recula aussitôt, épouvantée.
– Je ne sais rien, je ne les ai pas vus, se mit-elle à balbutier. L’une des sentinelles lui tendit mon laissez-passer. Elle poussa un cri.
– Nous voulons seulement que vous nous lissiez cela, camarade.
Hésitante, elle prit le papier et lut très vite :
Le porteur de ce laissez-passer, John Reed, est un représentant de la social-démocratie américaine, un internationaliste…
De nouveau sur la route, les deux soldats recommencèrent à délibérer.
– Il faut que vous veniez avec nous au comité du régiment, décidèrent-ils.
Dans le crépuscule qui s’épaississait rapidement, nous nous remîmes à patauger sur la route boueuse. De temps à autre nous rencontrions des groupes de soldats ; ils s’arrêtaient, m’entourant en me menaçant du regard et faisant circuler entre eux mon laissez-passer, en discutant s’il fallait ou non me fusiller.
Il faisait nuit quand nous atteignîmes les casernes du 2e fusiliers de Tsarkoïé-Sélo, rangée de constructions basses qui bordaient la grande route. Des soldats, qui faisaient les cent pas à l’entrée, se mirent à poser évidemment des questions. Un espion ? Un provocateur ? Nous montâmes un escalier en colimaçon et débouchâmes dans une grande salle nue. Une énorme poêle en occupait le centre, et sur des couchettes à même le sol, un millier de soldats jouaient aux cartes, bavardaient, chantaient, dormaient. Dans le plafond, les canons de Kérensky avaient ouvert une large brèche.
Je m’arrêtai à la porte ; le silence se fit soudainement dans les groupes, qui se tournèrent vers moi. Tout à coup, ils se mirent ne mouvement, lentement d’abord, puis s’élançant avec un bruit de tonnerre, les visages chargés de haine.
– Camarades ! Camarades ! criait l’un de mes gardiens. Comité ! Comité !
Ils s’arrêtèrent, serrés autour de moi et murmurant. Un jeune homme, qui portait un brassard rouge, se fraya un passage.
– Qui est-ce ? demanda-t-il avec rudesse.
Les sentinelles expliquèrent.
– Montrez-moi ce laissez-passer.
Ayant lu attentivement, tout en lançant vers moi de rapides coups d’œil, il sourit et me tendit le papier.
– Camarades, c’est un camarade américain. Je suis le président du comité et vous souhaite la bienvenue à notre régiment…
Un soupir de soulagement s’éleva, se transformant aussitôt en un rugissement de bienvenue. Tous se bousculaient pour me serrer la main.
– Vous n’avez pas dîné ? Nous avons déjà mangé. Nous allons vous mener au mess des officiers ; quelques-uns savent votre langue.
Il m’emmena à travers la cour jusqu’à la porte d’un autre bâtiment. Justement un jeune homme de mine aristocratique, portant les insignes de lieutenant, entrait. Le président me présenta et, après une poignée de main, s’éloigna.
– Je me nomme Stépan Georgiévitch Morovski. Je suis à votre entière disposition, me dit le lieutenant en un français excellent.
Du vestibule, richement décoré, un somptueux escalier éclairé par des lustres étincelants menait au deuxième étage, où des salles de billard, des salles de jeu et une bibliothèque s’ouvraient sur le palier. Nous entrâmes dans la salle à manger ; au centre, autour d’une longue table, une vingtaine d’officiers avaient pris place ; ils étaient en grande tenue, avec leurs épées à poignée d’or et d’argent et les rubans et les croix des ordres impériaux. Tous se levèrent avec politesse à mon entrée et une place me fut faite auprès du colonel, un homme de stature et d’aspect imposants, à la barbe grisonnante. Des ordonnances bien stylées servaient le dîner. L’atmosphère était celle de tous les mess d’officiers d’Europe. Où donc était la révolution ?
– Vous n’êtes pas bolchévik ? demandai-je à Morovski.
Un sourire fit le tour de la table, mais je surpris un ou deux regards furtifs vers les ordonnances.
– Non, répondit mon ami. Il n’y a qu’un seul officier bolchévik dans le régiment. Il est à Pétrograd ce soir. Le colonel est menchévik, le capitaine Kerlov, là-bas, est Cadet. Moi-même, je suis SR de droite… Je crois que la plupart des officiers de l’armée ne sont pas bolchévik, mais ils sont, comme moi, démocrates ; ils pensent qu’ils doivent suivre la masse des soldats…
Après le dîner, on apporta des cartes que le colonel étala sur la table. Tout le monde se groupa autour de lui.
– Voilà, dit le colonel en indiquant des marques au crayon, où se trouvaient nos positions ce matin. Vladimir Kirillovitch, où est votre compagnie ?
Le capitaine Kerlov mit le doigt sur la carte.
– Conformément aux ordres, nous nous sommes établis en bordure de cette route. Karsavine m’a relevé à cinq heures.
A ce moment, la porte s’ouvrit et le président du comité de régiment entra, suivi d’un autre soldat. Ils se joignirent au groupe entourant le colonel et suivirent sur la carte.
– Bon ! Dit le colonel. Les Cosaques ont reculé de dix kilomètres dans notre secteur. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’occuper des positions avancées. Donc, messieurs, tenez cette nuit la ligne actuelle, en renforçant les positions par…
– Permettez, interrompit le président du comité. Les ordres prescrivent de se porter en avant avec la plus grande rapidité et de se préparer à engager la bataille avec les Cosaques au nord de Gatchina demain matin. Une victoire écrasante est indispensable. Veuillez prendre les dispositions nécessaires.
Un court silence suivit. Le colonel revint vers la carte.
– Très bien, dit-il sur un ton différent. Stépan Géorgiévitch, s’il vous plaît…
Traçant rapidement de nouvelles lignes au crayon bleu, il donna ses ordres, tandis qu’un sergent sténographiait. Puis le sortit et rapporta au bout de dix minutes une copie dactylographiée des ordres en deux expéditions.
Le président du comité prit l’un des exemplaires et se mit à étudier la carte.
– Parfait, dit-il en se levant. Il plia la feuille et la mit dans sa poche. Puis, ayant signé l’autre et y ayant apposé un cachet rond qu’il portait sur lui, il a remit au colonel…
Maintenant, je reconnaissais la révolution !