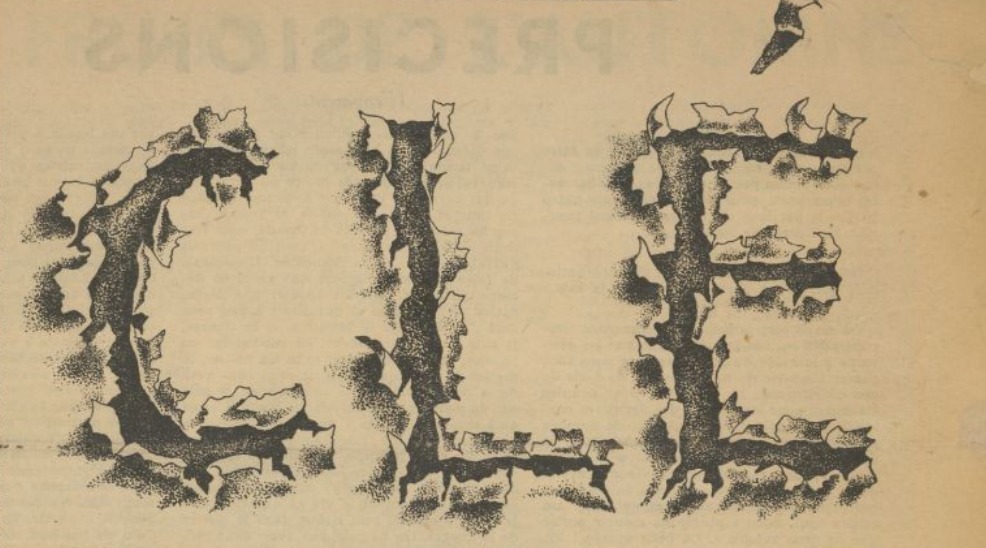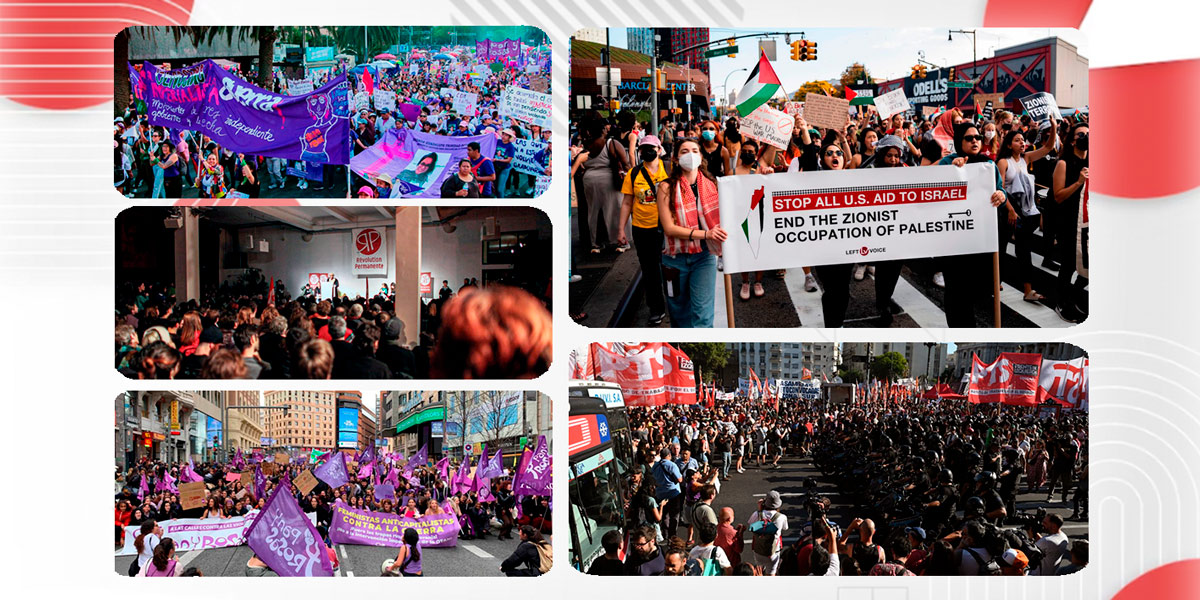Deux questions, distinctes quoiqu’indissociables, doivent notamment retenir l’attention. D’une part la nécessité vitale de renforcer l’auto-organisation dans la jeunesse et le monde du travail afin de contourner ou abattre tout obstacle à la construction d’une dynamique de grève générale reconductible. D’autre part la façon dont l’imaginaire et la pratique de « l’occupation des places », qui est un autre visage de l’auto-organisation, portée par le phénomène « Nuit Debout », saura ou non, s’intégrer à cette même dynamique. Si l’objectif d’un…mai 68 jusqu’au bout - et non d’un 1789 interclassiste – capable de « bloquer tout » a un sens aujourd’hui, ce sera en dernière instance nécessairement au travers de la paralysie de la production, dans le privé comme le public. Si l’occupation des places fait contagion en ce sens, le gouvernement sera rapidement confronté à son propre effondrement, et pas seulement son spectre. Sinon…
Retour en arrière. 1936, 1968 : sur les « deux étapes » du soulèvement révolutionnaire
1848, 1871, 1936, 1968… La France - là où la lutte des classes, disait déjà Marx, va le plus au fond des choses - a une longue expérience des mouvements de masse capables d’ébranler l’ordre capitaliste. Mais aussi une expérience toute aussi longue des capacités contre-révolutionnaires de ce dernier, en l’absence des outils, des perspectives et de la confiance permettant de faire basculer la révolte de masse en révolution. Revenons seulement sur une analogie parlante entre 1936 et 1968.
Quand on remonte en peu dans l’histoire des luttes de classes dans la France du XXe siècle, on évoque naturellement, d’abord, 1936 et le Front populaire. On se rappelle les manifestations, les occupations d’usine, et le plus souvent, on conclut avec les acquis historiques des accords de Matignon et au front électoral victorieux emmené par Blum. Mais le vrai « front populaire » avait été celui de la rue et des usines, la confusion de ces « deux fronts populaires », comme l’analysait déjà très justement Daniel Guérin dans Front populaire, révolution manquéeen 1963, étant savamment entretenue de longue date - en particulier par ceux qui, le PCF en tête, ne veulent pas que soit entendue la trahison,à l’occasion du front électoral, du mouvement réel.Dans Où va la France ?, Trotsky analysait 1936 à partir du schéma général de 1917, celui des « deux étapes » à la fois qualitativement distinctes et indissociables que sont (1) la révolte spontanée contagieuse, illustrée en l’occurrence par la grève générale de mai-juin 1936, et (2) le passage de la révolte à l’affrontement révolutionnaire pour la prise du pouvoir politique et économique. Que s’est-il passé ? Le potentiel révolutionnaire qui s’était exprimé, notamment, dans les comités d’action, s’est fait complètement anesthésier, et démobiliser par les directions syndicales et politiques.Les accords de Matignon, prototypes des accords-traîtres, sont signés en échange de l’évacuation des usines occupées, c’est-à-dire de l’abandon de la bataille contre la propriété privée, c’est-à-dire contre le pouvoir de la bourgeoisie.
Mai 1968 ? L’analogie entre 1936 et 1968 est importante sur ce plan. Certes l’histoire ne se répète jamais à l’identique, et toute analogie doit être maniée avec précaution, notamment parce que l’avenir n’est pas déjà écrit. Et entre les années 1930 et les années 1960 il y avait au moins deux grandes différences : (1) une crise économique profonde et la montée catastrophique du fascisme d’un côté – beaucoup plus proche de la période actuelle –, le plein-emploi dans un capitalisme « glorieux » de l’autre ; (2) la lutte étudiante, détonateur et acteur clé de mai 1968. Après le 13 mai 1968, qui remit sous les projecteurs la classe ouvrière, puis quasiment trois semaines d’une grève générale qui fut la plus importante de toute l’histoire de l’Europe occidentale, le retour du refoulé sévit de nouveau : comme les accords de Matignon en 1936, ceux de Grenelle, signés par les bureaucraties syndicales, montrèrent derechef à quel point, faute des garde-fous et des contre-pouvoirs nécessaires, des directions contre-révolutionnaires peuvent tuer la dynamique permettant le passage… de la première étape à la seconde
De 68 à aujourd’hui, si l’insubordination ouvrière et la radicalité étudiante se rencontraient vraiment…
La période inaugurée par le mai 1968 français, par-delà la révolte de la jeunesse étudiante à laquelle on le réduit abusivement le plus souvent, est celle d’une « poussée », d’une « montée ouvrière » qui va durer une décennie approximativement selon les pays, au niveau international. Cette période, incarnée par l’expérience autogestionnaire des LIP en 1973, fut marquée par de nombreuses grèves, occupations et séquestrations de patrons.Selon Xavier Vigna c’est bien d’insubordination ouvrière qu’il faut parler pour cette période (« le fait que de très nombreux ouvriers de ne soumettent plus, ou difficilement, à l’ordre usinier, à ses contraintes, à sa hiérarchie »), une insubordination qui consacra l’usine (et pas le parti ou le syndicat) et les cadres d’auto-organisation sur le lieu de travail (comités d’action, de grève, de lutte) comme le lieu de référence, non seulement de la production,mais surtout de la politique.Cette idée est importante car elle va à l’encontre du réductionnisme vulgaire habituel, selon lequel « ouvriers = syndicats » et « ouvriers = mouvement ouvrierorganisé et encadré par les partis de masse » (SFIO-PS, PCF), et parce qu’elle localise correctement la question politique – on y reviendra. Ce qui veut dire que dans certaines périodes agitées de la lutte des classes, l’action de la classe ouvrière tend à déborder ses cadres organisationnels normaux – sans pour autant que cela remette en cause la justesse de l’engagement syndical, hier comme aujourd’hui.
Les années 1970, sur fond de crise et de chômage croissants, puis le marasme des années 80 (jusqu’en 1995) et le début du néolibéralisme, ont progressivement eu raison de cette insubordination, la confinant dans la nostalgie autant que la démoralisation. Le patronat eut la part belle pour systématiser son offensive de destruction massive de la classe ouvrière, déconstruisant et déconcentrant l’appareil productif, et partant à l’assaut, au plan idéologique, de la « pensée 68 », de sa « révolution introuvable » (selon la formule du non regretté Aron). Terreau d’où fleuriront autant les critiques libérales de la révolution française, les falsifications historiques réactionnaires assimilant stalinisme, hitlérisme, marxisme, révolution et communisme derrière le vocable d’un « totalitarisme » nébuleux, mais hégémonique, auquel sacrifia longtemps une part très importante de la gauche la révolution conservatrice du PS à partir de 1981, constituant sa principale traduction politicarde. Sur la durée, c’est de ce processus de dégénérescence que lenéo-conservatisme social-libéral, qui s’est incarné ces dernières années dans la politique réactionnaire de Hollande et Valls, est issu, et toujours aussi férocement déterminé qu’à droite d’« en finir avec 1968 ».
Peuple de gauche orphelin, jeunesse en colère, classe ouvrière insubordonnée– des banlieues explosives… Ingrédients et contrastes de la « première étape »
Directement ou par le truchement du CPE en 2006, du plan Juppé en 1995, le spectre de 68 ne peut pas ne pas resurgir, à la fois par la frayeur engendrée par toute convergence de la jeunesse et de la classe ouvrière révoltées, et par le déplacement concomitant des horizons, par-delà les accommodements à l’existant, vers l’idée d’une autre société. L’appel à la « grève générale pour le retrait total », qui resurgit implacablement de chaque assemblée générale, de chaque cortège de la jeunesse, mais aussi de nombre de secteurs ouvriers mobilisés, véhicule ce spectre. La question des « deux étapes » se posera-t-elle à nouveau en 2016 ? Pas certain du tout, vu d’où nous partons. Difficile et vain, en tous cas, de prophétiser quoi que ce soit en l’état dans un sens ou un autre. Mais une chose est certaine : une combinaison explosive est proche de prendre forme, entre trois ingrédients.
D’abord, la radicalité de la jeunesse étudiante et lycéenne en lutte, haineuse de ce monde sans vie et de cette répression sanglante et arbitraire devenue l’habitude non seulement des fins, mais aussi des débuts et des milieux de manifs. Ensuite, l’aspiration à une société pacifiée et plus généreuse d’un pan majeur des anciens électeurs de Hollande,enseignants, cadres, classes moyennes, mais aussi une fraction notable des employés et ouvriers, au cœur de ce « peuple de gauche » dorénavant orphelin de représentant politique, qui croient sincèrement encore, quoique de moins en moins, qu’on peut améliorer l’existant, et en tous cas, pas à coups d’état d’urgence, de loi Travail, et de matraquage de lycéens de 15 ans. L’insubordination ouvrière génération 2000-2010, enfin, dans la tradition réouverte par les Conti, réactivée par les Air France et les Goodyear ; ainsi que toutes celles et ceux qui sont prêts à en découdre, qui à Roissy Air-France, qui à PSA Mulhouse, qui à Latécoère Toulouse, dans les entreprises, les services, chez les travailleurs privés d’emplois, ou ultra-précarisés, qui manifestent un refus croissant de se plier, surtout dans les jeunes générations, aux diktats de leurs syndicats, quand ceux-ci existent. Sans parler d’un quatrième acteur potentiel, qui pourrait synthétiser en soi une bonne part des trois autres ingrédients tout en mettant à nouveau le doigt sur le racisme néo-colonial congénital de la république policière : la jeunesse des banlieues, qui en connaît plus que n’importe qui sur l’état d’urgence, la misère sociale, le chômage et l’oppression.
Une orientation et un programme d’action capables de faire fusionner ces 3 + 1 composantes seraient absolument terribles pour le pouvoir. Penser, à l’aune de l’histoire, les réquisits du passage de la première à la seconde étape, constitue le point de vue avec lequel on pourra voir, derrière les contrastes juste naissants de l’actuel, de potentielles contradictions à moyen terme.Contradictions qui, faute d’une résolution appropriée, pourraient, comme en 2010, aboutir à la défaite pure et simple de la première étape elle-même, au début de laquelle (ou plus précisément, avec le 31, à la fin du début de laquelle), nous en sommes.
Empêcher le « Qui perd gagne » des patrons / le « Qui gagne perd » des bureaucrates
La première limite de la mobilisation actuelle est le caractère encore minoritaire descadres d’auto-organisation, en particulier les cadres interprofessionnels, au travers desquels l’insubordination et la colère des prolétaires d’aujourd’hui pourraient s’agglomérer de façon à pouvoir proposer une orientation au mieux complémentaire de celle de l’intersyndicale nationale, mais en rupture frontale, si nécessaire, avec elle - si celle-ci choisit de freiner ou de briser dans les faits, par-delà les discours et les postures, la lutte en marche.Le fait que soient à la tête de la lutte d’aujourd’hui les syndicats dits « contestataires » explique sûrement - par surcroît de l’accumulation de défaites parachevée par la défaite de 2010 - ce retard de développement d’une organisation indépendante. L’important est que la seule politique que les travailleurs peuvent déployer en propre, et qui à la fois peut seule attaquer les fondements même du pouvoir patronal et gouvernemental, c’est celle de la grève ; d’une grève qui du reste n’a pas vocation à seulement optimiser les départs en manifestations ou bloquer la production, mais doit surtout permettre aux travailleurs en lutte de s’organiser eux-mêmes et de commencer à mettre en dispute, dans telle et telle boite, le pouvoir de leur patrons, sans parler de l’occupation des usines et la reprise en main directement démocratique de la production qui en serait la destination adéquate. Même chose, avec leurs spécificités, dans les universités et les lycées, la clé étant que jeunes et travailleurs arrivent à synchroniser, soutenir et renforcer mutuellement leurs mobilisations en ce sens.
Bref, selon la formule de Trotsky en 1936, le « Qui perd gagne » est depuis lors le classique des patrons et des gouvernements bourgeois qui acceptent de perdre un peu en apparence pour gagner beaucoup, les « partenaires sociaux » jouant le jeu du « dialogue social négocié », glosant sur le peu gagné pour jeter le voile sur tout ce qui est perdu, continuant aujourd’hui, même s’ils ne sont pas encore tous austade de dégénérescence criminelle et de trahison crasseuse de la CFDT, à tenir les rênes. La lutte pour l’auto-organisation, c’est la lutte contre ce « Qui perd gagne » patronal, c’est-à-dire ce « Qui gagne perd » bureaucrate.
« Nuit debout » : « occupation des places » et « grève générale » face à leurs destins
La seconde limite pourrait émerger rapidement de l’« indignation à la française » dont la réalité est en train de commencer, avec Nuit Debout, place de la République à Paris, mais aussi dans un certain nombre d’autres villes.La Coordination Nationale Etudiante qui s’est réunie ce week-end à Rennes, sans en faire l’alpha et l’oméga de son programme, appelle officiellement à s’y joindre. Et ici et là, se multiplient les structures syndicales qui l’incluent dorénavant dans leur modalités d’action et invitent à y participer. Nuit Debout peut-il être la centrifugeuse de la mobilisation actuelle, capable de briser la routine des cortèges saucissonnés en secteurs et organisations, tout en en constituant une caisse de résonance et un prolongement servant l’affrontement avec le gouvernement ?
Le pire scénario serait que l’occupation des places, ne finisse, consciemment pour certains, sans se rendre compte de l’enjeu pour d’autres, par se substituer à l’objectif de la grève générale, soit d’un blocage massif de la production capitaliste. Un tel substitutisme n’est pas écrit d’avance, et d’autre part peut prendre toutes sortes de formes. Mais le fond en resterait le même : celui, au mieux, d’une mise en équivalence des processus, c’est-à-dire complémentarité purement mécanique, méconnaissant le fait que « bloquer » la production, mettre en péril le fonctionnement normal de la propriété privée des moyens de production, est le fondement stratégique de tout affrontement potentiellement victorieux du pouvoir du capital.Dès mai 2011 des questions de ce type ont surgi de la mobilisation du « 15 Mai » espagnol, faisant rejaillir le spectre de 68, et soulevant la nécessaire enquête sur les conditions de développement conséquent de ce mouvement de masse. Entre le printemps arabe, l’indignation gréco-espagnole, la contagion « Occupy », le « mouvement des places » de 2011 a effectivement constitué une véritable bombe socio-politique faisant exploser la chape de plomb des défaites accumulées antérieurement du mouvement social et ouvrier. De même aujourd’hui, « Nuit Debout » incarne un processus politique grandissant de réappropriation d’un espace-temps structurellement capturé par les pouvoirs institués. Processus d’autant plus éminemment progressiste que la rue et l’espace publics font l’objet, comme nous savons tous, d’une militarisation croissante et d’une répression sans nom - sans parler de tout ce qu’il coagule et exprime des aspirations à changer la société, à réinventer et reconstruire une existence collective solidaire et populaire, contre les cloisonnements, l’isolement, le repli et finalement l’invisibilisation des existences et de leurs combats.
Mais ce que l’on doit aussi retenir de ces indignations de 2011, c’est leur échec total, à terme, pour ébranler réellement le pouvoir capitaliste et ses institutions politiques.
Occuper les places, oui. Mais, à la condition d’y unir les travailleurs en lutte, de battre en brèche toute logique de dilution « citoyenne » du rôle spécifique de la classe travailleuse, ouvrière ou prolétarisée sous l’effet de la crise (ce qui en élargit encore le périmètre), donc d’articuler ce processus d’occupation de l’espace public à la perspective de la grève générale : un « bloquons tout ! » pourrait cette fois faire sens de façon intégralement progressiste. Mais cette première condition, même satisfaite, ne suffirait pas. La CGT elle-même le dit, la lutte actuelle est « contre le capital ». Cela ne l’empêche pas de proposer des perspectives purement réformistes à la mobilisation actuelle, et de se positionner comme celle qui freine le passage à l’acte de la grève reconductible. La seconde condition est donc, simultanément, de lutter d’un même mouvement contre les directions bureaucratiquement citoyenno-réformistes, et « indignées-néoréformiste s », qui, ne manqueront pas de pousser au train pour chevaucher une telle « indignation à la française ».
Parler de direction « néoréformiste », c’est bien sûr avoir à l’esprit ici le modèle « Podemos », porté de longue date par une partie du Front de gauche et de la gauche radicale comme le modèle à suivre, mais qui a pourtant, comme Syriza en Grèce, montré combien ce type de débouché politique d’une colère sociale de masse, portée par les travailleurs et la jeunesse, est le meilleur outil dont dispose la bourgeoisie pour faire avaler la pilule. Bien sûr, tous ceux qui se réfèrent, aux pourtours de Nuit Debout, à Podemos ou Syriza s’empressent à juste titre de dénoncer leurs capitulations. Mais dénoncer ne suffit pas. On ne peut pas dissocier le phénomène Podemos de ce dont il a été le débouché contradictoire : à la fois un processus politico-électoral qui a progressivement dévié et canalisé sur le terrain des institutions de la démocratie bourgeoise une mobilisation qui se faisait sur le terrain de l’affrontement social ; mais qui a pu œuvrer en ce sens en s’appuyant sur un des éléments structurants de « l’indignation » de 2011 : sa dimension citoyenne-populaire pas du tout délimitée sur le plan de l’affrontement de classes, et la minoration assortie - voire carrément la dilution - du rôle stratégique de la classe ouvrière pour porter cet affrontement à terme.
Si, nous revendiquons ! Mais nous ne nous contentons pas de revendiquer…
La leçon de 68, mais aussi de 2010 ? Construire la plus large auto-organisation au moyen de cadres capables de faire émerger ou de se constituer en authentiques directions alternatives à tout frein bureaucratique, d’où qu’il vienne. La leçon des naufrages de Syriza et de Podemos ? Ne pas laisser la logique du débouché politique néoréformiste et néopopuliste de gauche s’arroger la signification et la direction politique d’un éventuel enracinement, dans la France de 2016, d’une « indignation à la française » inédite. C’est sûrement la lucidité explicite sur ces conditions qui a déjà amené, notamment Frédéric Lordon, qui est en passe de jouer le rôle qui fut celui de Bourdieu en 1995, à proposer une hypothèse stratégique qui mérite l’attention.
Sans conteste une figure naissante de ce mouvement d’ensemble, Lordon est, comme la mobilisation actuelle, à la croisée de ses chemins : soutenant à la fois la mobilisation de la jeunesse et des travailleurs, comme en témoignesa participation active au Meeting de convergence à Tolbiac du 30 mars, etson inscription dans le phénomène politique de « Nuit Debout », où il est déjà intervenu à plusieurs reprises, il montre par le fait combien les deux processus sont parfaitement compatibles, et porteurs ensemble d’un « Tous ensemble » explosif. Mais compatibles aujourd’hui, ils ne le resteront pas nécessairement demain, en tous cas, pas spontanément.
Quand Lordon affirme que « nous ne revendiquons rien », dans ce mouvement mais qu’au contraire, « nous affirmons », il met l’accent sur la nécessité de fuir le terrain de la négociation avec l’existant, que toute démarche de « revendication » est censée selon lui envelopper, pour, à l’opposé, porter à la concrétude la brisure de l’isolement et du cloisonnement qui font le pouvoir institué, et, ce faisant, esquisser un nouveau processus constituant, à la fois d’une autre société, et d’une autre forme de pouvoir – illustré, dans un autre texte, par la perspective des quarante-huitards du XIXe siècle, contre la république bourgeoise, de la « république sociale »(en un entre-deux suggestif, mais questionnant, entre 1789 et mai 1968). Assurément, il travaille ce faisant sur la restauration d’un sens du possible tout à fait vital aujourd’hui. Mais derrière le « sens du possible », toutes les options stratégiques ne se valent pas. Un texte collectif, dont il est l’un des signataires, « Écrivains et intellectuels soutiennent « l’action de rue » contre la loi travail.Pourquoi nous appuyons la jeunesse » avait formulé dès le 21 mars certaines hypothèses sur les façons dont la mobilisation devrait prendre corps. Il sera utile d’en discuter, pour conclure, le principal présupposé.
D’où naîtront donc « l’affirmation » et l’alternative politiques ?
Nous sommes évidemment d’accord avec la nécessité réaffirmée dans cette tribune de « sortir des limites fixées par les différentes bureaucraties », et reconnaissons d’autant plus avec eux la justesse de la volonté de « rester dans la rue et d’occuper des places » que les signataires sont bien conscients des limites du procédé et n’en font naturellement pas une fin en soi :« Mais nous avons appris ces dernières années que les occupations de places à elles seules ne suffisent pas à bloquer le fonctionnement des institutions. Le risque qu’elles contiennent est de se contenter d’exister, d’attendre leur évacuation ou leur épuisement. » Diagnostic partagé.
En revanche, un désaccord avec la perspective alternative proposée dans la foulée : « À notre sens, elles doivent donc plutôt servir de base depuis lesquelles prendre les lieux d’où les « représentants du peuple » prétendent pouvoir le gouverner, et à l’occasion le matraquer. Mairies, conseils divers, assemblées soi-disant régionales ou nationales, tout cela mérite d’être investi, repris, assiégé ou bloqué. Nous devons viser le blocage organisé du pouvoir politique. »
En quel sens, et contre quel pouvoir exactement, les places doivent-elles servir de « bases » ? Comment pouvoir envisager de se « réapproprier » ces organes de la démocratie bourgeoise, fussent-elles locales et en apparence plus accessible à la réappropriation démocratique « pour de vrai », pour les transformer en leur contraire sans affronter le régime social qui leur sert structurellement d’assise ? C’est en « prenant les lieux » du pouvoir matérieldont le pouvoir politique est l’acolyte et le prolongement qu’un pouvoir politique alternatif pourra voir le jour. Les lieux de travail, mais aussi d’études – qui exploitent, harcèlent et précarisent autant que dans n’importe quelle boîte, tout en produisant à la chaîne la future force de travail « compétente »et flexible qu’attendent les patrons – ne sont pas seulement des lieux de « revendications » ni même seulement de « blocage » de la production capitaliste : leur réappropriation au moyen de la grève des occupations, par les travailleurs et les étudiants s’auto-organisant, et leur coordination à l’échelle nationale,sera, comme Vigna l’a bien montré sur les années 68, la voie pour faire émerger un pouvoir politique alternatif, sans solution de continuité possible avec ces lieux officiels de la pseudo-démocratie policière : celui de la démocratie directe que, justement, les quarante-huitards avaient esquissés, avant de faire l’expérience de la répression de masse, inaugurant cette histoire de la démocratie prolétarienne dont l’avenir sera encore à bâtir sur les ruines fumantes du capital.
C’est en ce sens que la construction de la grève générale est tout sauf la simple généralisation d’une liste interminable de « revendications » ou d’un volumineux… cahier de doléances.Il est évident qu’elle s’appuiera, comme elle s’appuie déjà, sur des revendications, celles qui cristallisent très concrètement, par ce qu’ils subissent chaque jour, l’entrée en résistance de millions de personnes. Et ces luttes pour la défense ou la (re)conquête d’un certain nombre de droits, le mot d’ordre du retrait total de la loi travail permet actuellement de les fédérer. Mais s’il s’agit réellement, sur cette base, de porter une vision des affects et des corps sociaux et politiques incompatible avec la misère ambiante, généreuse, solidaire, populaire, et si les places occupées sont l’instrument de contagion de cette vision, ce ne sera pas dans le dos de la grève générale, mais au contraire, c’est, dialectiquement, en l’animant, en la prolongeant, en la faisant résonner dans tous les interstices de l’espace-temps idéologique, médiatique et politique, soit, en s’appuyant consciemment dessus comme le pivot stratégique incontournable de ses propres aspirations. C’est ainsi qu’une alternative sociale, économique et politique au pouvoir bourgeois, que la véritable « affirmation » capable d’instituer un ordre nouveau, pourra germer. Sinon, nous perdrons.